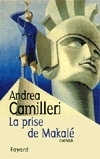|
Andrea Camilleri : "Le dialecte exprime le sentiment"
C''est à l'âge où les autres penchent vers la retraite, leur vie plus ou moins derrière eux, qu'Andrea Camilleri s'est changé en star. Pas juste un écrivain fameux, entouré de respect, d'admiration, le genre de célébrité que personne ne reconnaît dans la rue - bien mieux que cela et surtout bien plus rare, quand il s'agit de littérature : une vedette, avec un fan-club très officiel, des groupies qui l'appellent gentiment "Il Sommo" ("le plus haut", en référence à Dante), des photos de lui bébé sur Internet et ses livres en tête des listes de meilleures ventes, semaine après semaine et souvent plusieurs titres à la fois. A 80 ans passés, ce Sicilien natif de Porto Empedocle, dans la province d'Agrigente, jouit depuis quinze ans d'une popularité sans égale en Italie. Poussé par le succès de Montalbano, commissaire bourru et plein d'humour dont il a fait le héros de ses romans policiers, Camilleri continue d'écrire et de publier des récits incroyablement savoureux et drôles, mêlés de dialecte et portant, presque toujours, un regard très politique sur l'Italie.
Ce n'est un mystère pour personne, là-bas, Camilleri n'aime pas Silvio Berlusconi. Encore le mot est-il faible : "En Italie, le fascisme s'est transformé en berlusconisme", déclare-t-il entre deux cigarettes. Ou faudrait-il dire "à cheval" sur deux cigarettes, puisqu'il n'y a justement pas d'entre-deux pour ce fumeur gargantuesque : dans le petit bureau de son appartement romain, au quatrième étage d'un immeuble cossu, façade rouge et volets bruns, le gros cendrier déborde - des blondes mal éteintes ou pas éteintes du tout, qui font la ronde. "Berlusconi, dit-il, a été une anomalie totale, une contingence historique. A mes yeux d'homme de gauche, un gouvernement de droite entre dans le jeu démocratique, mais lui est à part, comme Mussolini." Tout de même, une exception qui a rencontré l'approbation de la moitié des Italiens, vis-à-vis desquels Camilleri se montre particulièrement sévère : "Beaucoup d'Italiens n'aiment pas l'honnêteté. Leur morale est celle du "motorino" (scooter), qui peut monter sur les trottoirs, rouler à contresens, se garer en quadruple file, bref : profiter de ceux qui respectent la loi et s'arrêtent au feu rouge."
Pour lui, qui a passé toute son enfance dans un pays régenté par Mussolini, le fascisme n'est pas seulement un mot, une insulte que l'on jette à la figure de ses adversaires. "C'est un virus, dont on a cru se débarrasser en pendant le chef par les pieds, mais qui revient depuis des décennies, sous des formes différentes." Il la connaît d'autant mieux, cette maladie, que sa famille en était atteinte. Son père, inspecteur des ports de Sicile méridionale, qui avait participé à la marche sur Rome, et sa mère, un peu moins impliquée, mais sympathisante quand même. Si bien qu'à dix ans, juste après le début de la guerre d'Ethiopie, le petit Andrea n'avait qu'un désir : "Tuer des Abyssins" - ambition dont il fait part au Duce, dans une lettre enflammée. "Il m'a répondu, le cornuto, que j'étais trop petit pour faire la guerre, mais que les occasions ne manqueraient pas, dans l'avenir. Le jour où elles se sont présentées, bien sûr, je ne voulais plus."
LANGUE EXTRAORDINAIRE
C'est en repensant à cette lettre et à ses "années kamikaze" qu'il a écrit La Prise de Makalé (traduit par Marilène Raiola, Fayard, 284 p., 18 €), sans doute l'un de ses livres les plus étonnants. L'un des plus dérangeants, aussi, parce qu'il entrelace politique et sexualité (sur un mode assez cru) autour d'un héros de 7 ans, Michilino, tout petit garçon très intelligent et doté d'un "sexe d'homme". A travers ce personnage, qui subit l'endoctrinement fasciste de l'époque et la perversité sexuelle des adultes (liée, entre autres, à l'érotisation du chef), Camilleri donne une idée saisissante de ce que peut être la monstruosité. L'enfant devient une créature abominable, glaçante, à l'image du fascisme lui-même, ce qui n'a pas manqué de bousculer le lectorat traditionnel de Camilleri. "De tous mes romans, c'est celui qui a eu les plus mauvaises critiques en Italie, affirme l'écrivain. Beaucoup de gens se sont contentés d'y voir un petit livre pornographique, ce qui n'est pas étonnant, puisque ici, le fascisme est nié."
L'histoire a beau prendre pour décor la bourgade sicilienne imaginaire de Vigàta, dont Camilleri se sert dans la plupart de ses romans, le ton est évidemment différent de celui qui prévaut dans les autres livres - beaucoup plus tragique et profondément trouble. Mais la manière, ce mélange d'ironie, de farce et d'acuité historique, cette façon particulière d'évoquer un pays et ses habitants, n'est pas sans rapport avec les récits historiques publiés jusque-là (par exemple La Disparition de Judas ou La Concession du téléphone, aux éditions Métailié, ou le splendide Roi Zozimo, chez Fayard.) Et pas même avec les "Montalbano", qui ont fait le succès de leur auteur, dès le début des années 1990, avant que les romans n'inspirent une série télévisée de grande audience. Car tous ces textes sont portés par la langue de Camilleri, bouillonnement verbal inventif et perspicace, grand chaudron où barbotent avec bonheur des éléments de différents dialectes (sicilien, bien sûr, mais aussi vénitien, génois ou romain) dont les nuances deviennent des éléments de l'intrigue.
Depuis toujours, Camilleri a mis du dialecte dans ses récits, comme l'avait fait avant lui Luigi Pirandello, son grand concitoyen (né à Agrigente, en 1867). Toujours, c'est-à-dire depuis son premier roman, Le Cours des choses, paru en 1978 (Fayard, 2005). Poète prometteur, dans sa jeunesse, puis longtemps metteur en scène de théâtre, scénariste et producteur pour la radio et la télévision (il habite encore tout près de la RAI, où il travailla de nombreuses années), Camilleri, s'était mis, sur le tard (à 42 ans), à l'écriture d'un roman. Mais le dialecte n'avait pas bonne presse au milieu des années 1960 et le manuscrit fut refusé, dix ans durant, par tous les éditeurs. Aussi n'est-ce pas à beaucoup plus de deux décennies que remonte la carrière littéraire d'Andrea Camilleri, pourtant riche de nombreuses parutions. "Quand j'ai eu mon premier livre publié entre les mains, explique-t-il, ce fut comme ouvrir une bouteille de champagne."
"En italien, je n'arrive pas à dire tout ce que je veux, observe-t-il. C'est un peu la langue des notaires. Pour reprendre Pirandello, le dialecte exprime le sentiment, là où la langue exprime le concept." Chez les Camilleri, on parlait l'un et l'autre, parfois dans la même phrase. Quand Andrea rentrait trop tard, sa mère lui faisait de tendres reproches en dialecte avant de le menacer, en italien, de ne plus jamais lui donner une lire. Langue de la famille, de l'intimité, le dialecte est sans doute ce qui attire tant d'Italiens vers les livres de Camilleri.
"Le jeu de Camilleri avec la langue amuse les gens, indiquait au Monde l'une de ses traductrices, Dominique Vittoz, à la parution d'Un filet de fumée (Fayard, 2002). Il a libéré les Italiens dans leurs rapports avec le dialecte." Par la même occasion, il a "mis un livre dans la poche de tous les Italiens", constate l'écrivain Erri De Luca, ce qui n'est pas rien.
"Le Vieux", comme l'appellent ses compatriotes, est aussi l'artisan d'un glissement du "polar" vers la littérature. "Un mouvement qui s'était déjà produit chez Gadda, dans L'Affreux Pastis de la rue des Merles, remarque ironiquement Camilleri, mais personne ne s'en était aperçu... Il faut reconnaître qu'il ne disait pas qui était l'assassin ! Et puis il y a eu Sciascia : Le Jour de la chouette, par exemple, est un véritable roman policier." Quoi qu'il en soit, c'est lui, Camilleri, qui a vraiment fait basculer le préjugé. Pas seulement à cause de sa langue extraordinaire, jonction de plusieurs dialectes, mais à cause de cette manie qui consiste à aller regarder sous les apparences d'une société - pointer, mine de rien, les vilaines habitudes, les gros péchés, les qualités de coeur et les accès de poésie. Parler, en somme, du monde réel, ce qui est l'une des vertus de la littérature, quelles que soient les fins qu'on lui prête et les moyens qu'elle se donne.
Raphaëlle Rérolle, LE MONDE DES LIVRES - 15.06.06
|